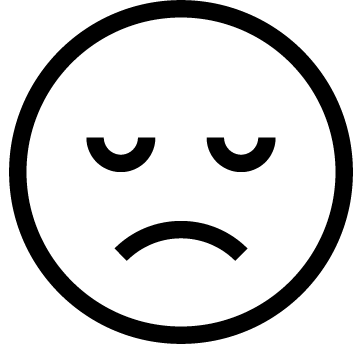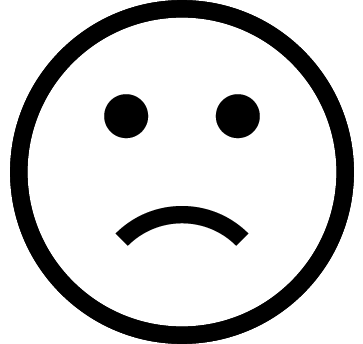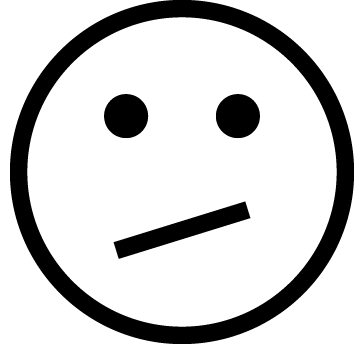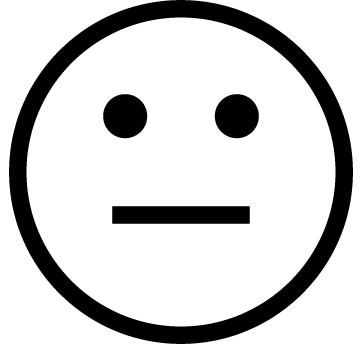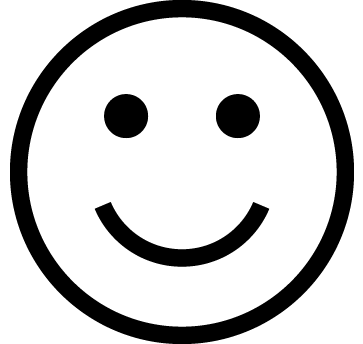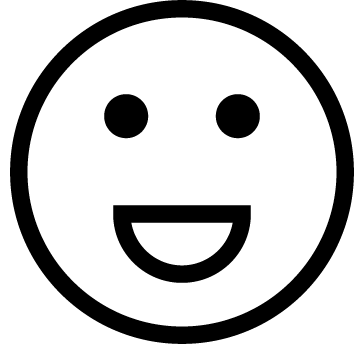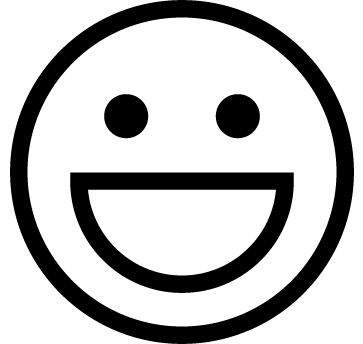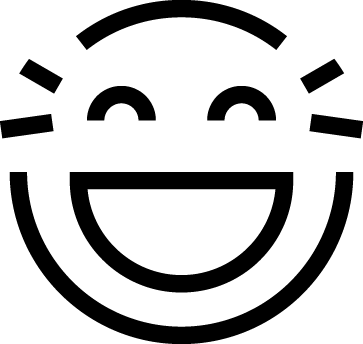This article is not available in english.
Le Québec en 2060 (2)!
Le Québec en 2060!
Si l'on se fie aux derniers résultats de l'enquête de l'IRB, nous n'avons pas fini de parler d'immigration et « d'accommodements raisonnables ». D'abord, parce que la majorité des Québécois (57 %) croit que les immigrants constitueront la majorité de la population du Québec d'ici 50 ans. En 2035, nous n'en serons pas loin.
Comment pourrait-il en être autrement? Le taux de natalité (1,7 %) est encore largement en dessous du seuil de renouvellement qui se situe à 2,1 enfants par femme. De plus, le nombre de décès dépassera celui des naissances vers 2035.
Le Québec, progressivement, sera composé de deux sociétés distinctes. Trois même. Montréal l'île, Montréal la région et les autres régions. Alors que plus de Québécois pensent que l'on devrait obliger une certaine partie des immigrants à s'installer en région (42 % en accord vs 31 % en désaccord), dans les faits, 74 % d'entre eux s'installent à Montréal ce qui n'est pas sans exacerber les différences. Le tiers des Québécois qui considèrent que les personnes qui vivent en régions sont plus xénophobes et intolérantes envers les immigrants ne pourra alors qu'augmenter, l'incompréhension des uns face aux autres s'intensifiant et créant des tensions inutiles et stériles.
L'âge moyen des Québécois, en 2035, sera de 44,3 ans alors qu'il est actuellement de 41 ans. Pire, le nombre de travailleurs pour chaque retraité passera de 3,9 qu'il est actuellement à 2,5 toujours en 2035. Comment réagiront les jeunes que l'on se plaît, à tort d'ailleurs, de traiter d'égoïstes alors qu'en fait, ce sont les Boomers qui devraient hériter de ce qualificatif peu enviable? Jusqu'où supporteront-ils les vieux?
Plusieurs régions seront décharnées, appauvries et leurs poids démographiques ne justifieront plus l'importance qu'elles occupent encore aujourd'hui.
Pas de doute. La société québécoise change et rapidement. Mais vers où s'en va-t-elle? À quoi ressemblera-t-elle? Bien malin qui pourrait le dire, mais les données de l'IRB fournissent des pistes et alimentent une foule de questions.
Comme on l'a vu, le clivage entre Montréal et les régions du Québec n'ira-t-il qu'en grandissant. Pas facile, dans ce contexte, d'identifier des projets rassembleurs et mobilisateurs dans lesquels ces deux sociétés se sentiront tout aussi fortement interpellées.
Comment réagiront les « Québécois de souche » devant le changement drastique du paysage social de la province? Pourront-ils garder leur poids relatif et leur influence?
Seront-ils assez nombreux pour préserver leurs organes d'informations, fortement orientées francophones?
Les entreprises médias, dont la majorité sont maintenant des entreprises boursières, trouveront-ils les raisons financières pour maintenir leurs programmations « québécoises » et francophones?
Les Québécois de toutes confessions trouveront-ils la sagesse de construire une nation basée sur la tolérance, la compréhension, le respect des peuples fondateurs et l'entraide plutôt que sur le parti pris, l'exclusion, la crainte et l'individualisme?
Le Québec « de souche » aura-t-il la maturité et la confiance nécessaires pour assumer des choix qui affaibliront sa position traditionnelle, mais qui le porteront vers une nouvelle réalité incontournable?
La liste des questions pourrait évidemment s'allonger, questions auxquelles il n'est pas facile de fournir des réponses claires. N'oublions pas que l'intolérance des uns face aux autres et que les différentes tensions raciales sont deux des principales préoccupations des Québécois qui demeurent 41 % à penser que le Québec devrait freiner l'immigration.